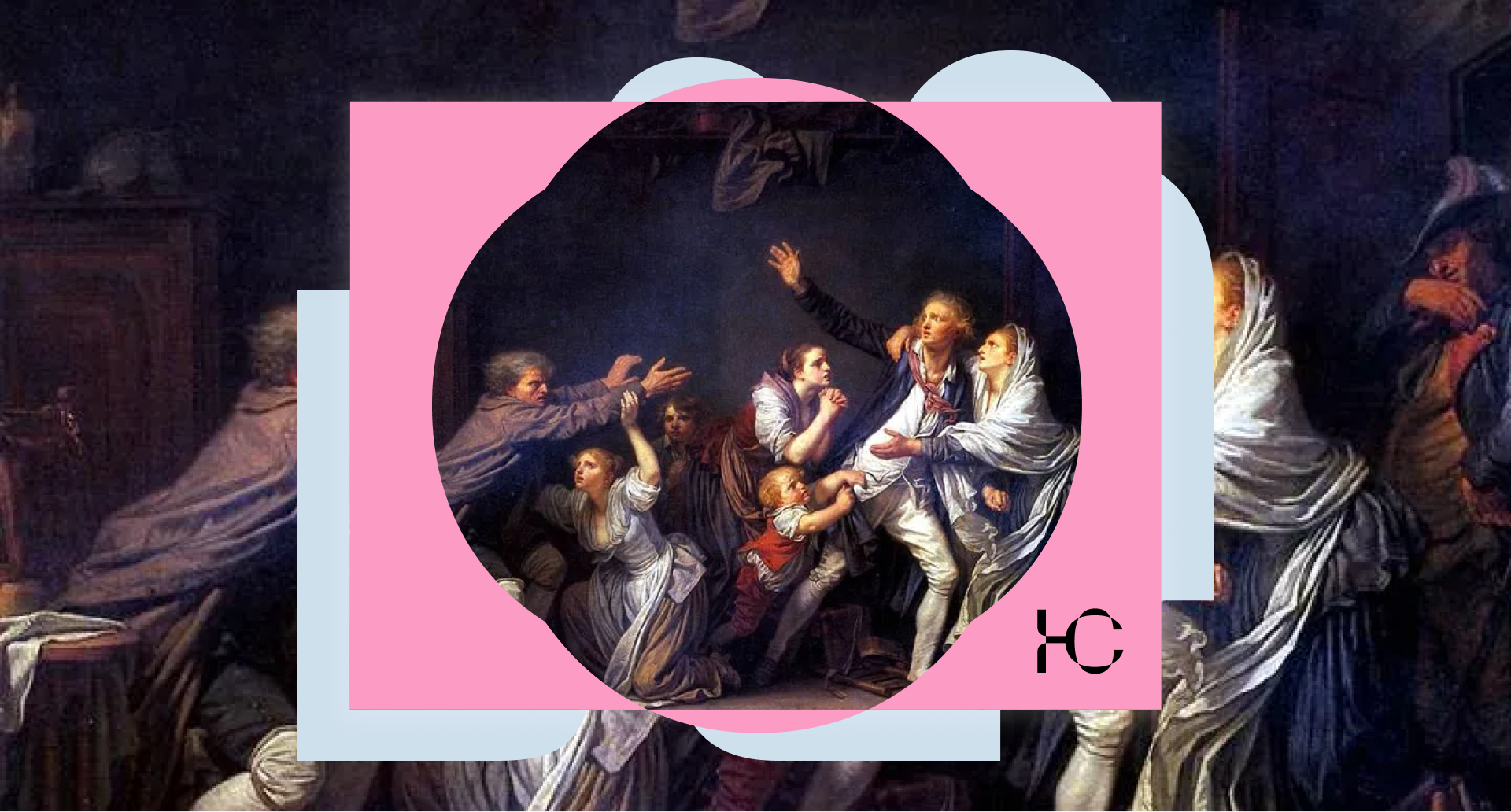Cher toi,
Un proverbe africain affirme la chose suivante :
"Il y a trois vérités : ma vérité, ta vérité et ce qui s'est réellement passé."

Alors que je cherche l’inspiration pour démarrer cette missive et que je contemple les bougies de ma couronne de l'Avent, les flammes qui dansent devant moi me rappellent étrangement nos histoires familiales. Parfois vives, parfois vacillantes, elles ressemblent à ces vérités qui se transmettent en murmures, jamais vraiment exactes, toujours transformées et ces secrets qui se glissent dans les silences pour venir se tapir au fin fond de notre inconscient.
Ces danses subtiles ne sont pas seulement celles de nos mémoires individuelles. Elles résonnent également dans les pas de Clélia et Giulia. Aujourd'hui, leur quête de vérité nous invite à regarder de plus près les ombres et les lumières qui façonnent nos propres histoires.
🎙️ Nouvelle capsule
Dans l’épisode du jour, nous remontons les ruelles d’un petit village italien où les vieilles rancunes s’entrelacent avec des légendes familiales. Des murmures surgissent, des accusations enfouies remontent à la surface.

Les erreurs du passé sont-elles des poids à porter ou des chaînes à briser ?
Comme tu as pu l’entendre, les secrets des Bianchi ressurgissent sous forme de rumeurs – des accusations de trahison et de non-assistance pendant la Grande Guerre. Mais derrière ces murmures se cache une vérité bien plus complexe, liée au rôle imposé aux membres de cette famille au fil des générations.
Je te propose maintenant d'explorer deux concepts clés de la systémie familiale qui éclairent particulièrement cette histoire : l'enfant de remplacement et la rumeur. Ces deux phénomènes, apparemment distincts, s'entrelacent souvent dans nos histoires familiales comme les fils d'une même tapisserie.
Les échos du passé : les enfants de remplacement
Imagine un instant un petit garçon de trois ans, debout devant une pierre tombale. Sur celle-ci est gravé son propre prénom : "Vincent van Gogh". Non loin, sa mère dépose des fleurs, pleurant un autre Vincent, né et mort un an jour pour jour avant sa naissance. Cette scène, qui s'est réellement déroulée, est un excellent exemple du concept d'enfant de remplacement.
🔎 Une définition
Introduit dans les années 1960 par le psychiatre Maurice Porot, ce concept décrit un phénomène où un enfant naît après la perte prématurée d'un frère ou d'une sœur, et se voit inconsciemment investi des attentes ou des espoirs projetés sur l'enfant disparu.
Comme l'explique si justement la psychanalyste Marie-José Soubieux dans "Le Deuil périnatal", ce n'est pas tant le fait d'avoir un autre enfant après une perte qui pose problème, mais bien les attentes inconscientes associées à cette naissance. Ces attentes, souvent lourdes et implicites, peuvent façonner l'identité de l'enfant, le plaçant dans une quête difficile de différenciation et d'autonomie psychologique.
💣 Un poids invisible : le mandat transgénérationnel
💡 Selon les travaux de Celia Blanco-Davila, jusqu’à 15% des enfants nés après une perte périnatale portent ce qu’elle appelle un mandat transgénérationnel.
Cela signifie que l’enfant peut être inconsciemment perçu comme ayant pour mission de :
- remplacer l’enfant disparu, en reproduisant ses qualités idéalisées,
- racheter la douleur familiale, en incarnant une réussite ou une réparation symbolique,
- assumer un rôle particulier dans la dynamique familiale, souvent sans en avoir conscience.
Ces projections peuvent interférer avec le développement de l’enfant en tant qu’individu unique, entraînant des troubles de l’identité, un sentiment d’insatisfaction ou une quête permanente de validation.
🕵🏻♀️ Trois destins marquants
Les impacts de ce statut se retrouvent parfois dans les vies de figures célèbres, dont les parcours artistiques ou psychologiques portent les traces de cette double filiation, à la fois visible et invisible.
1️⃣ Vincent Van Gogh : l’artiste tourmenté
Vincent Willem Van Gogh est né le 30 mars 1853 dans une famille aristocratique hollandaise où l'art et la religion occupaient une place centrale. Mais dès sa naissance, Vincent portait un poids invisible : il était le deuxième Vincent Willem Van Gogh, un enfant "de remplacement", né exactement un an jour pour jour après un frère aîné mort-né portant le même nom.
▪️Le poids d'un prénom et d'un anniversaire partagé
Son enfance est marquée par la tombe d'un autre Vincent : chaque anniversaire de Vincent était une visite au cimetière familial, où sa mère pleurait l'enfant perdu devant une pierre tombale portant son propre nom.
Enfin, en plus la répétition du prénom, on retrouve un syndrome anniversaire à l’oeuvre avec la répétition de la date de naissance. Vincent vivait la vie d'un autre, incapable de trouver sa propre place.
▪️Une quête impossible d'identité et de reconnaissance
Vincent suit les traces de son oncle (marchand d'art) et de son père (pasteur), mais échoue à incarner l'un ou l'autre rôle.
À 27 ans, il devient peintre autodidacte et entame une vie d'isolement, marquée par des troubles psychologiques (épilepsie, hallucinations, dépression).
La naissance, en 1890, d'un autre "Vincent Van Gogh" – le fils de son frère Theo – est vue par certains comme la clôture de sa mission d'enfant de remplacement. Quelques mois plus tard, il se donne la mort, comme s'il n'y avait plus de place pour lui.
▪️Le tableau des "Premiers pas"
Anne Ancelin Schützenberger voit dans le tableau Les premiers pas une métaphore de l'incapacité de Van Gogh à trouver sa place au soleil, à exister en tant qu'individu à part entière.

2️⃣ Salvador Dalí : le double surréaliste
Dalí, lui aussi, est marqué par le deuil familial. Né après la mort de son frère aîné Salvador, il grandit avec l'idée qu'il est la réincarnation du disparu. Sa mère lui répétait cette phrase lourde de sens : "Tu es lui."
▪️L'ambivalence de l'enfant de remplacement
Très tôt Dalí éprouve le besoin de se différencier et développe une personnalité exubérante et des œuvres extravagantes, une manière de crier au monde qu'il est "autre".
Il voue une réelle obsession pour la mort : le spectre de son frère décédé traverse son art, à la fois dans ses thématiques et dans sa méthode qu'il qualifie d'"interprétation paranoïaque critique".
▪️Le "mythe tragique" de l'Angélus de Millet
Salvador Dalí interprète L’Angélus de Jean-François Millet comme une œuvre imprégnée de deuil et de symbolisme inconscient. Il considère que les personnages, bien que présentés comme des paysans priant pieusement, expriment en réalité une douleur liée à la mort. Selon Dalí, la posture des figures – en particulier la femme inclinée – reflète un acte de recueillement sur une tombe ou un cercueil.

Obsédé par cette hypothèse, il insista pour que des analyses soient faites sur le tableau. Une radiographie a révélé un élément intrigant : sous la couche de peinture se trouve une forme rectangulaire, interprétée par certains comme un cercueil d’enfant.
Comme Van Gogh, Dalí explore fréquemment les tensions entre vie et mort, particulièrement en relation avec son propre héritage. L’idée de remplacement, d’individuation face à une figure absente ou idéalisée, traverse son œuvre. Ce parallèle entre Dalí et Van Gogh est frappant : tous deux luttent pour dépasser un poids inconscient imposé par leur histoire familiale et par leur statut d'enfant associé à un frère disparu ou idéalisé.
3️⃣ Camille Claudel : l’artiste effacée
Bien que moins médiatisé, le cas de Camille Claudel est tout aussi poignant. Née après un frère mort en bas âge, elle incarne la promesse de continuité pour ses parents endeuillés. Cependant, ce rôle invisible l’a enfermée dans une dynamique complexe avec sa famille.
Luttant pour s’imposer comme artiste dans une société patriarcale, Claudel a également dû composer avec des attentes implicites liées à son statut. Si son génie artistique s’exprime dans ses sculptures, sa quête d’autonomie a été entravée par des relations toxiques et des pressions psychologiques, notamment celles de sa famille.

Ce qu’il faut retenir
Être un enfant de remplacement ne signifie pas forcément vivre une existence marquée par le mal-être. Cependant, cela peut représenter un défi identitaire important. La clé pour ces enfants réside dans la possibilité de reconnaître ce mandat invisible et de s’en affranchir en construisant une identité propre, détachée des attentes inconscientes des générations passées.
Ce sujet soulève des questions universelles : jusqu’à quel point nos vies sont-elles influencées par les attentes familiales et comment pouvons-nous nous en libérer pour devenir pleinement nous-mêmes ?

La rumeur
Dans cet épisode, une rumeur accuse la famille Bianchi d'avoir laissé mourir des villageois pendant la Grande Guerre. Ce murmure collectif, porté par des non-dits et des rancunes, devient une arme puissante qui divise et blesse sur plusieurs générations.
🔎 Les clés sociologiques de la rumeur
Jean-Noël Kapferer, dans Rumeurs : Le plus vieux média du monde, identifie trois caractéristiques fondamentales :
1️⃣ Un contexte d'incertitude : les rumeurs surgissent lorsque les faits sont flous, incertains. Ici, les traumatismes de la guerre ont amplifié cette ambiguïté.2️⃣ Le besoin de donner du sens : les rumeurs comblent les vides laissés par l'absence d'explications. Elles créent un récit là où le silence règne.3️⃣ Une dynamique de transmission : une rumeur se propage d'autant plus vite qu'elle touche à des émotions fortes, comme la peur ou la colère.
Dans notre récit, la rumeur remplit une double fonction :
- elle protège un secret – celui des expériences sur le vin médicinal,
- elle renforce les divisions communautaires, en désignant les Bianchi comme des "traîtres".
🧠 Les mécanismes psychologiques
La complexité des rumeurs familiales repose sur des mécanismes psychologiques profonds qui dépassent la simple transmission d'information. Ces mécanismes révèlent souvent davantage sur ceux qui propagent la rumeur que sur son objet même.
▪️La projection collective : le miroir de nos peurs
Les rumeurs fonctionnent comme des écrans de projection collective où un groupe dépose ses angoisses et ses désirs inavoués. Dans le cas des Bianchi, le vin médicinal cristallise des peurs ancestrales. La peur de l'empoisonnement, profondément ancrée dans l'imaginaire collectif depuis le Moyen-Âge, s'entremêle avec une ambivalence face au pouvoir de guérison, entre espoir et méfiance.
Cette projection révèle souvent les tensions sociales d'une époque : en temps de guerre, la figure du "traître" devient le réceptacle idéal des angoisses collectives.
▪️L'effet de vérité illusoire : le pouvoir de la répétition
Ce phénomène, étudié par les psychologues sociaux, montre comment notre cerveau tend à considérer comme vrai ce qui est répété régulièrement.
Plus nous entendons une information, plus elle nous semble familière et véridique.
Dans une petite communauté, cet effet est particulièrement puissant car les interactions répétées créent une chambre d'écho où la rumeur se renforce continuellement.
▪️La rumeur dans les dynamiques systémiques : un outil de régulation familiale
Les familles, comme tout système, cherchent constamment à maintenir leur équilibre (la fameuse homéostasie dont je t’ai déjà parlé). La rumeur devient alors un instrument sophistiqué de régulation familiale. Le maintien de l'équilibre passe par la rumeur qui agit comme une soupape de sécurité, permettant d'évacuer les tensions sans confrontation directe.
La désignation du "mouton noir" sert à localiser le "problème" sur un membre spécifique. Paradoxalement, ce membre devient essentiel au système, car il porte la responsabilité des dysfonctionnements familiaux.
Les non-dits fonctionnent comme un écran de fumée, détournant l'attention des véritables enjeux tout en créant une "vérité alternative" plus acceptable que la réalité.
Dans le cas des Bianchi, la rumeur de trahison pendant la guerre masque probablement des dynamiques plus complexes : des jalousies anciennes liées au statut social de la famille, des conflits autour de la transmission du savoir médicinal, et des tensions entre tradition et modernité dans la pratique de la médecine.
Cette compréhension des mécanismes nous permet de voir la rumeur non plus comme une simple médisance, mais comme un symptôme révélateur des dynamiques familiales et sociales sous-jacentes.
🛠️ Un outil pratique
Pour analyser ou désamorcer une rumeur, voici la méthode SCAN.
1️⃣ Source » D'où vient cette rumeur ? Qui en parle ? 2️⃣ Contexte » Pourquoi surgit-elle maintenant ? Quel événement ou conflit la nourrit ?3️⃣ Analyse » Quels besoins ou peurs cette rumeur exprime-t-elle ? 4️⃣ Nécessité » Est-il utile ou constructif de la propager ?
🎯 À toi de jouer : la cartographie émotionnelle
Ce dont tu as besoin :
- une grande feuille blanche
- trois crayons ou feutres de couleurs différentes
- un moment calme où tu ne seras pas dérangé
Première étape : les racines de l'arbre
Commence par dessiner le tronc - c'est toi. Trace ensuite les branches principales - tes parents, grands-parents. N'hésite pas à inclure les personnes significatives, même si elles ne sont pas liées par le sang.
Deuxième étape : la cartographie des émotions
Pour chaque personne représentée sur ton arbre. Par exemple :
- en vert : note une force, un don qu'elle t'a transmis (par exemple : "la passion de grand-père pour la musique"),
- en bleu : inscris une histoire familiale marquante liée à cette personne,
- en rouge : indique un non-dit ou une tension que tu ressens.
Troisième étape : les liens invisibles
Trace des lignes entre les personnes ou les événements qui te semblent connectés Note les patterns qui se répètent à travers les générations. Observe où se concentrent les couleurs : y a-t-il des zones plus "chaudes" ou plus "froides" ?
Quatrième étape : les graines de transformation
Choisis un élément "rouge" de ton arbre. Pose toi les questions suivantes : comment pourrais-tu transformer cette difficulté en ressource, quelle nouvelle branche aimerais-tu faire pousser ?
Un exemple concret : prenons Eva, qui découvre que sa peur de prendre la parole en public résonne avec l'histoire de sa grand-mère, forcée au silence pendant la guerre. En prenant conscience de ce lien, elle peut transformer cette peur en une force : devenir la voix que sa grand-mère n'a pas pu être.
Questions clés pour explorer ton arbre
- Quel message invisible ai-je reçu de ma famille ?
- Quelle histoire se répète ?
- Quelle nouvelle histoire je souhaite écrire ?
Prends ton temps pour cet exercice. Tu peux y revenir plusieurs fois, le compléter progressivement. C'est un outil vivant qui évolue avec ta compréhension de ton histoire.
Aujourd’hui, Clélia et Giulia ont découvert que les histoires qu'on (se) raconte – qu'elles soient vraies ou construites – façonnent nos vies. Mais elles vont bientôt réaliser que, pour avancer, elles devront distinguer vérité et mensonge, accepter certains héritages et en rejeter d'autres.
Comme elles, tu es toi aussi porteuse ou porteur d’héritages, de murmures et d’ombres. Explorer tes racines et les mettre en perspective te permet de choisir avec intention ce que tu souhaites transmettre et ce que tu veux laisser derrière toi.
À demain pour en découvrir encore plus sur la famille Bianchi et son passé.
Excellente soirée,
Hélène
PS 1 : la meilleure manière de me dire MERCI est de laisser un ❤️ ici et de partager cette newsletter et les podcasts.
PS2 : si ce n’est pas déjà fait, tu peux aussi :
- me suivre sur Linkedin et Instagram.
- booker un call découverte de 30 mn (offert).
- lire toutes les éditions précédentes.