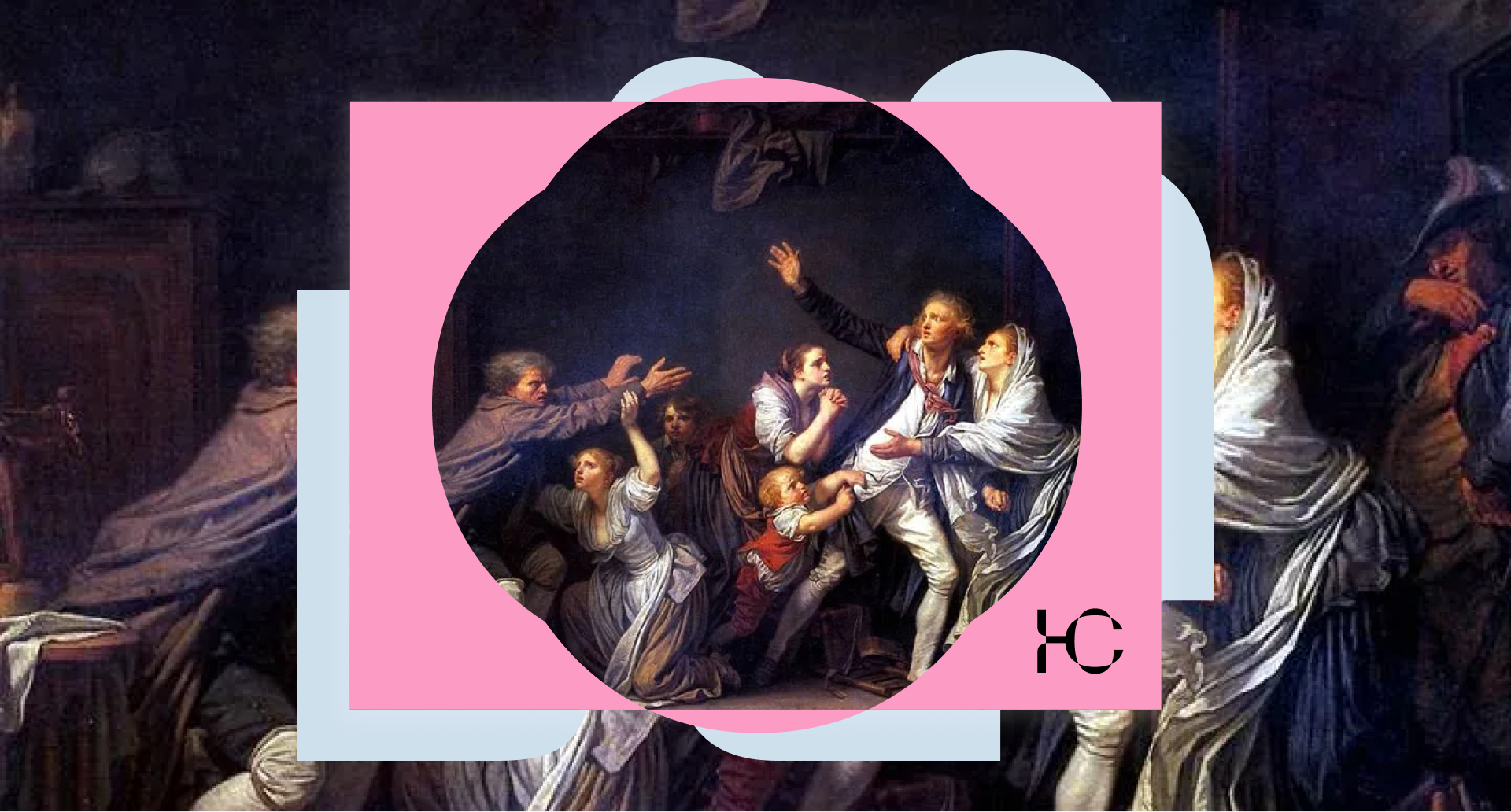Cher toi,
Plus de deux semaines sans newsletter de ma part… Tout va bien, mais j’ai été bien occupée. Je reviens avec une édition fleuve mais je n’arrivais pas à faire moins tant je voulais te donner des clés pour faire face à l’échec.
Par ailleurs, dès demain, je commencerai à diffuser des infos sur le podcast qui arrive enfin prochainement et je vais reprendre ma plume sur Linkedin.
Sondage
Au fait, quel est le sujet que tu aimerais que je traite cette semaine ?
Les limites
25%
La névrose de classe
13%
Trouver sa raison d'être
50%
La double contrainte
13%
Autre
0%
Si tu as répondu « autre », réponds à ce mail pour me faire ta suggestion.
C’est parti pour l’édition sur l’échec.
Note : Cette newsletter est très longue. Le sommaire détaillé te permettra de naviguer directement vers la partie qui t’intéresse si tu souhaites gagner du temps ! Et si tu la lire dans sa totalité, clique sur View entire message à la fin du mail que tu as reçu.
Cette semaine, une de mes coachées, que nous nommerons Isabelle, me confiait son sentiment profond d'échec et d'incompétence. Après une ascension professionnelle, elle avait décidé de quitter son poste, se sentant inadéquate. Rapidement, elle en avait trouvé un autre et, un an plus tard, les fondateurs lui exprimaient leur déception. Une fois de plus, elle se sentait confrontée à l'échec. À ce sentiment d’insatisfaction professionnelle s’ajoutait un sentiment d’échec personnel. La gestion de son temps la laissait avec peu de moments à consacrer à ses enfants, un fait que l’on ne manquait pas de lui rappeler, que ce soit à la crèche à 18h30 ou lors des repas en famille.
Lors de nos échanges, elle m’explique qu’elle a décidé de faire une pause avant de s’engager dans un nouveau poste, se sentant déboussolée face à la multitude des possibilités et des obstacles. Elle craint d’avoir manqué une opportunité en restant généraliste et doute désormais de la possibilité de concilier un bon salaire, un emploi intéressant et un épanouissement personnel et familial. Malgré tout, au plus profond d'elle-même, elle aspire à cette harmonie. Sa peur de l'échec la paralyse, la laissant dans l’incertitude concernant ses choix professionnels futurs.
Des « Isabelle » , j’en ai accompagné beaucoup et chaque fois que j’entends de tels discours, cela me révolte. Cependant, après cette réaction épidermique, je prends mon bâton de pèlerin et je me mets au travail.
Isabelle n’est pas une perdante, ni une personne pessimiste. Elle est, comme une immense majorité d'entre nous, victime d’une vision, d’une histoire, d’un narratif qui, constamment répété et érigé en norme, nous fait croire à une FAUSSE réalité. L’échec ne nous définit pas. Il s'agit simplement d'une question de perspective et il est grand temps que cette prise de conscience imprègne notre esprit et notre âme.
Les racines du mal
En France, le terme « échec » résonne comme une sentence lourde. En le prononçant, c’est comme si nous avions jeté un sort, condamnant de facto celui à qui on l’appose à l'infamie.

Curieusement, tu noteras qu’il en va de même avec le « succès » ou la « réussite » que nous n’aimons pas étaler par peur d’être taxé.e de vantard.e et qui, tout de suite, éveille la suspicion. « Qu’a-t-elle ou il pu bien faire pour mériter cela ? »
Nous sommes embourbés dans une perspective qui voit la réussite économique comme suspecte et l'échec comme inacceptable.
Cette mentalité trouve son fondement dans l'éducation, dans notre culture et dans une surprenante méprise linguistique.
Une éducation du « pas assez »
Le système éducatif français perpétue cette mentalité en rendant souvent les élèves prisonniers d'un cadre où le moindre écart est synonyme de faillite. Le mot « pas assez » résonne comme un leitmotiv étouffant.
N’as-tu pas connu ou toi-même été Clément ? Ce jeune élève est très doué en arts plastiques mais n’a pas la moyenne en mathématiques. Au lieu de valoriser ses compétences et d’encourager un potentiel chemin vers une carrière artistique, l’accent est mis sur ses erreurs mathématiques, le poussant à croire qu'il n'est pas à la hauteur.
En notant et évaluant les élèves sur leur habileté à éviter les fautes plutôt que sur leur capacité à tirer des leçons de leurs échecs, nous mettons en berne leur créativité et leur capacité d’innovation.

Un simple « peut mieux faire » sur un bulletin, loin d’être un encouragement, enfonce davantage l'élève dans la peur de l'échec.
Mettons-nous à la place d’Élise qui reçoit ce commentaire sur son bulletin à la suite à d’une « mauvaise » note à son contrôle d’histoire. Plutôt que d'y voir une incitation à s'améliorer, elle y voit une critique, une insuffisance, une tache sur son parcours scolaire impeccable.
Il serait pourtant bien plus fructueux de montrer à Élise que son erreur en histoire, par exemple, où elle a tenté une approche originale mais incorrecte pour analyser un événement, est une preuve d'originalité et de pensée critique. Cette perspective différente peut être la source de succès futurs si elle est guidée et affinée. Cette approche valoriserait l'audace, la créativité et le désir de réessayer, définissant l'échec comme une étape vers la réussite et non comme une fin en soi.
Tout comme dans les conseils de classe en France, notre monde professionnel suit le même état d’esprit : le focus est souvent mis sur les faiblesses plutôt que sur les réussites des employés.
Une culture du parcours linéaire
En France, cette perspective négative est omniprésente et peut même être qualifiée de culturelle. Nous sommes obsédés par les origines, le quartier où l’on a grandi, et en particulier le diplôme que nous avons obtenu.
Le graal de la réussite étant, pour beaucoup, le concours scolaire obtenu à 20 ans, qui marque par la même occasion votre identité jusqu’à votre dernier soupir… Paradoxalement, la France a construit un système d’études supérieures formant les élites du pays qui passe, les premières années, par l’expérience souvent brutale de la défaite. Dans mon entourage, l’échec subi à 20 ans est devenu une blessure narcissique à vie pour bon nombre de mes camarades.
Cet état d’esprit entrave notre capacité à accepter l'échec comme une étape normale et nécessaire du chemin vers le succès. L'échec est perçu comme une honte, et celui qui échoue est souvent stigmatisé, perdant la confiance et le respect de son entourage.
Contrairement à la France, aux États-Unis, la mentalité est radicalement différente. L'échec y est vu comme une étape d'apprentissage cruciale. Des figures emblématiques comme Steve Jobs, Bill Gates et Henry Ford ont tous connu des échecs majeurs avant de réaliser des succès retentissants. Ils ont appris de leurs erreurs et les ont utilisées comme tremplin pour atteindre des sommets encore plus élevés. Aux États-Unis, l'échec n'est pas une fin, mais un passage, un moyen d'acquérir de l’expérience et de la sagesse pour les projets futurs. Par contre, que connait-on des échecs de Bernard Arnault ou François Pinault ?
En effet, notre culture nous fait percevoir l'échec sous un jour sombre et limitant et nous pousse à le mettre sous le tapis.
Résultat : cette mentalité crée un environnement dans lequel la prise de risque et l'audace sont constamment dévalorisées, bloquant ainsi notre potentiel et nos aspirations.
Cette relation problématique avec l’échec se retrouve jusqu’au mot lui-même.
Un malentendu linguistique
Sais-tu de quel verbe est issu le nom commun « échec » ? Beaucoup répondraient hâtivement : « échouer ». C’est faux. Les termes se ressemblent mais n'ont en fait rien à voir. Il est d’ailleurs fort probable qu’il n’existe pas de verbe directement lié au nom échec.
Le terme « échouer » trouve ses origines dans le monde maritime, signifiant « mener un bateau à l’échouage ». Un bateau échoué, bloqué temporairement sur un rocher ou un banc de sable, attend simplement la marée pour se déséchouer. L’échouage n'est donc que temporaire.

Le verbe « échoir », sans connotation négative, signifie quant à lui « être dévolu par le sort à quelqu’un ». Le hasard peut donc nous attribuer aussi bien des bonnes que des mauvaises choses. Si tu gagnes au loto, un gain t'est échu. N'est-ce pas à des années-lumière de l'idée d'échec ?
En ancien français, le mot échec signifie butin, c’est-à-dire le prix gagné après une victoire. Quelle ironie que de lier échec et victoire ? Cette étymologie nous ramène à l'idée de hasard. En effet, qui sait réellement quel butin il recevra en guise de récompense ?
La perception négative de l'échec que nous avons aujourd'hui provient d’une mauvaise interprétation du jeu d'échecs. En persan, le terme « Shah mat » signifie : le roi est vaincu ou impuissant, et non mort. Tout joueur d'échecs sait que le roi n’est jamais tué durant la partie, il est simplement bloqué.
Cette analogie avec l’échouage maritime nous rappelle que l’échec, comme un bateau échoué, est souvent temporaire. Un simple retour de marée, ou un effort conscient, peut nous remettre en mouvement vers de nouvelles victoires.
N’est-il pas temps - enfin - de revisiter notre perception et notre définition de l’échec ?
Six clés pour changer de perspective
Notre perception de l'échec joue un rôle crucial dans notre capacité à l'affronter et à en tirer profit. En le considérant comme une honte ou un signe de faiblesse, tu te condamnes à l’inaction alors qu’en décidant de le prendre comme une occasion d'apprentissage et de développement, tu te permets de progresser.
Tu n’es pas ton échec
Il est essentiel de ne pas confondre un échec avec ta valeur en tant que personne. Ce concept semble simple en théorie, mais en pratique, il peut être difficile à intérioriser. L'erreur est souvent perçue comme une tache indélébile sur notre identité, poussant à des sentiments d'infériorité et de dévalorisation personnelle.
Rappelle toi que l'échec n’est qu’un événement, un moment dans le temps, et non une caractéristique personnelle inamovible, est fondamental. L'échec est une expérience, pas une définition de ce que nous sommes.
L’échec est simplement la non-obtention d’un résultat attendu à un instant T.
Prenons l’exemple d’un athlète qui ne remporte pas de médaille lors d’une compétition majeure. Cela ne signifie pas que son talent et ses années d’entraînement intensif sont nuls. Bien au contraire, chaque échec peut servir de tremplin pour l'analyse, le réajustement des stratégies et des techniques, la motivation pour travailler encore plus dur et la préparation pour les prochaines compétitions. Michael Jordan a lui même déclaré :
J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matches. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi.
Proposition d’exercice
Pour intérioriser cette séparation, écris une lettre à toi-même post-échec. Décris l’échec objectivement, comme un observateur extérieur. Souligne que cet incident n’affecte pas ton intégrité, ta valeur ou tes capacités globales. Cette lettre doit être un rappel positif de ta valeur intrinsèque, indépendamment des circonstances extérieures.
Chaque fois que tu ressens un doute, relis cette lettre.
Le sentiment d’échec est principalement une histoire d’ego
Nous avons tendance à vivre l’échec comme une attaque personnelle, un rejet direct de nos compétences, de notre valeur ou de nos idées. Cette perception est largement influencée par notre ego, cette partie de nous qui cherche la reconnaissance et la validation extérieure. Lorsque notre ego prend un coup, le sentiment d’échec est exacerbé, parfois au-delà de la réalité objective de la situation.
La vérité crue c’est que « tout le monde s’en fout » ou si je suis moins directe et plus polie : les gens sont généralement absorbés par leurs propres vies, leurs propres problèmes et leurs propres échecs. Même si un échec peut te sembler monumental, il est probablement passé inaperçu ou sera rapidement oublié par les autres.
Lors de son discours inaugural en 2009, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama a trébuché sur les mots du serment présidentiel. Puis, plutôt que de prononcer « I will faithfully execute the Office of President of the United States », Roberts a dit les mots dans le désordre, et Obama l'a suivi. Cela a créé une petite confusion qui a certes été remarquée par certains médias, mais qui n’a pas entaché la cérémonie d’inauguration et personne ne s’en souvient aujourd’hui. La majorité du public se rappelle plutôt du mandat historique d'Obama et de son discours inaugural inspirant.
De même - encore une histoire américaine !! - Abraham Lincoln que tu connais certainement comme étant un des plus grands présidents des États-Unis a eu un parcours riche en échec avant d'accéder à ce poste : il a perdu huit élections, a fait faillite deux fois et a subi une dépression nerveuse.
N’avons-nous pas un peu de marge ou du moins pouvons-nous éprouver un peu de bienveillance sur les aléas que nous rencontrons ?
Tous les avis n’ont pas la même valeur
Il est vital de prendre du recul par rapport aux opinions d'autrui. Chaque personne a une perspective unique, façonnée par ses propres expériences et convictions et ne peut totalement comprendre le chemin que tu parcours. Par ailleurs, tous les conseils que tu peux recevoir n’ont pas la même valeur : certains sont enrichissants et porteurs de sagesse, d’autres sont le reflet de préjugés ou d’incompréhensions.
En action avec Isabelle
Imaginons que Isabelle ma coachée veuille se lancer à son compte. En fait, elle y a déjà pensé et aussitôt qu’elle a émis cette idée, elle a été confrontée à des avis divergents et parfois négatifs de son entourage. Sa meilleure amie lui a dit que lâcher un boulot qui payait bien était à la fois égoiste et hérétique. Sa belle-mère - qui n’a jamais pratiqué après ses études de médecine et qui s’est occupée de ses 4 enfants - lui a fait comprendre que ce n’était pas très responsable. Mais, ces personnes n’ont aucune expérience en entrepreneuriat ou dans le secteur dans lequel Isabelle veut se lancer. Leurs intentions sont certainement bienveillantes, par contre leurs conseils ou critiques ne sont pas forcément pertinents ou utiles, faute d'expertise ou de compréhension du domaine en question.
L’histoire regorge d’exemples qui nous prouvent que bien souvent les critiques et la déviance sont des voies de sirènes qui ne prédisent en rien le succès de notre entreprise.
- Lorsqu’Elon Musk a fondé SpaceX en 2002, créer une entreprise privée de fusées spatiales semblait absurde pour beaucoup de personnes. Les experts de l'industrie spatiale et le public étaient très sceptiques quant à la viabilité de SpaceX. Lors des trois premiers lancements de l'entreprise, les fusées ont échoué, exacerbant les doutes et les critiques. Pourtant, Musk a choisi d'ignorer les sceptiques et a continué à croire en son projet. Il a investi son propre argent dans SpaceX. En 2008, le quatrième lancement a finalement été un succès, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale et la reconnaissance de la vision d'Elon Musk.
- Lady Gaga a rencontré une myriade de critiques tout au long de sa vie. Lorsqu’elle a débuté dans l’industrie musicale, elle a été jugée, critiquée et moquée pour ses choix de costumes excentriques et son style musical distinctif. Mais, elle n’a pas laissé les opinions négatives d’autrui définir sa carrière ou sa valeur personnelle et a continué à exprimer son art de la manière qu'elle estimait juste. Avec le temps, elle a non seulement prouvé qu'elle était une musicienne talentueuse, mais aussi une actrice accomplie, remportant même un Golden Globe pour son rôle dans la série télévisée American Horror Story.
Proposition d’exercice
Pour muscler ta confiance en toi et prendre du recul face aux avis extérieurs, identifie cinq réussites personnelles que tu as accomplies indépendamment ou en dépit de l'opinion des autres.
Note-les dans un journal ou un document.
Ces réussites te serviront de rappel que ton chemin et ta vision sont valides et précieux, même face à l’adversité ou au doute exprimé par autrui.
L’échec est souvent partagé
J’écoutais ce matin un extrait de l’épisode de podcast de Pauline Laigneau qui sort aujourd’hui (lundi 2 octobre). Elle y interviewe Hélène Bourbouloux, administratrice judiciaire haute en couleurs et star de la restructuration de dettes & du redressement d’entreprise. Autant dire qu’elle s’y connaît en matière d’échecs et voici l’analyse qu’elle partage.
Je pense que quand on réussit si on est un peu lucide, on fait partie des ingrédients de la réussite. Mais, il y a tout un tas d’ingrédients qui fait partie de la réussite. Et d’ailleurs, les chefs d’entreprise les plus smart, se gardent bien de s’octroyer le bénéfice de cette réussite. C'est sympa d’être celui qui prend la lumière mais la réalité, c’est que dans l’équipe, il y a en un qui est le phare et les autres, c’est les bâteaux. Et le phare, sans les bateaux, ca donne rien.
Dans les difficultés et dans l’échec, c’est pareil. Penser qu’on est celui qui est la cause des difficultés, c’est un manque d’humilité. C’est la réponse à cette réussite. Alors, il y a une vertu, c’est qu’on analyse beaucoup plus facilement les causes des difficultés que les causes de sa réussite parce qu’on a moins envie de se mettre dedans. Même si vis à vis de l’extérieur, on le vit mal, on se sent un peu humilié, etc., en son fort intérieur, on peut avoir une analyse un peu plus critique et en faisant cela, l’échec ou la difficulté est souvent beaucoup plus contributif du parcours futur que la réussite.
La peur de l’échec est pire que l’échec
Comme tu le sais certainement, la peur est une émotion qui se manifeste dans deux types de scénarios : quand il y a un danger ou une menace réelle et quand le cerveau pense que tu sors de ta zone de confort. Notre cerveau ne fait bien souvent pas la différence entre les deux et c’est pourquoi la peur d’échouer peut susciter chez toi un sentiment de danger aussi grand si tu étais attaqué.e par un tigre aux dents de sabre (espèce disparue il y a plus de 20 000 ans).
Dans le cas d’un vrai danger, nous passons en mode pilote automatique pour notre survie. C’est ce qui nous a sauvé de nombreuses fois à l’époque préhistorique. En revanche, dans notre quotidien actuel, les peurs que nous éprouvons pour une reconversion professionnelle, un changement de vie, une création d’entreprise sont disproportionnées.
Dans ce contexte, il est important de réaliser qu’il est beaucoup plus douloureux de passer complètement à côté de sa vie et de ses rêves, juste parce qu'on manque de courage, que d’échouer. En effet, ne pas agir par peur de l'échec garantit le seul échec définitif : celui de ne jamais essayer.

Si besoin est, voici à nouveau des exemples pour apporter de l’eau à mon moulin.
- Steven Spielberg a été refusé plusieurs fois par l’école de cinéma de l’Université de Californie du Sud, avant de devenir l’un des réalisateurs les plus influents de l’histoire du cinéma.
- Walt Disney a été licencié par un rédacteur de journal parce qu'il "n'avait pas d'idées originales et ne faisait pas assez de bon travail". Disney a également fait faillite plusieurs fois avant de construire Disneyland.
- Le Colonel Sanders, fondateur de KFC, a été rejeté 1009 fois avant de trouver un restaurant qui voulait acheter sa recette de poulet frit.
-
Ces exemples illustrent la nécessité de persévérer malgré les peurs et les échecs, et montrent que le succès peut être à portée de main si l’on est prêt à prendre des risques et à apprendre de ses erreurs. La peur peut être une alliée si elle nous conduit à la vigilance. Mais, ce n’est pas le cas lorsqu’elle devient paralysante.
Alors, comment apporter une réponse rationnelle à une émotion instinctive ? L’exercice suivant, inspiré du « fear-setting » de Tim Ferris, va te permettre de prendre du recul.
Proposition d’exercice
Avant de démarrer, identifie et nomme le possible échec qui te fait peur.
Étape 1 : le scénario du pire
Sur une feuille, détaille le pire scénario que tu peux imaginer en cas d'échec, sans aucune retenue. Par exemple, en cas de reconversion professionnelle, envisage la réaction de ton entourage, la baisse possible de ton niveau de vie et toutes les autres conséquences négatives.
Étape 2 : les antidotes
Sur une seconde feuille, trace un tableau à 3 colonnes où tu noteras tes peurs dans une colonne, puis les antidotes possibles à tes peurs dans la seconde colonne. Pour cela, pense à des actions concrètes que tu pourrais entreprendre pour les prévenir ou les atténuer. Par exemple, dans le même cas de reconversion pro, expliquer tes plans à votre entourage ou faire des économies pour vous offrir une sécurité financière pourraient être des antidotes.
Étape 3 : les réparations
Complète la troisième colonne par des solutions de réparation. En cas d'échec malgré les stratégies mises en place, comment pourrais-tu rectifier la situation? Prévois des plans d’action, comme demander de l'aide à un proche ou renégocier un prêt bancaire.
Étape 4 : le scénario du meilleur
Sur une seconde feuille, note tous les bénéfices que tu pourras obtenir en cas de succès. Imaginez le meilleur scénario possible et liste tous les avantages, à la fois personnels et professionnels, que tu pourrais en tirer.
Étape 5 : le coût de l’inaction
Sur une quatrième feuille, réfléchis aux conséquences de l’inaction. Que se passera-t-il si tu ne fais rien ? Évalue le coût de ton inaction sur le court, moyen et long terme, tant sur le plan physique qu’émotionnel et financier.
En suivant ces étapes, tu pourras prendre des décisions plus éclairées et moins influencées par la peur de l'échec et faire la différence entre un sentiment primal exagéré et une prudence mesurée et aidante.
Le nombre d’échecs est une métrique du succès
Chez Google, les équipes doivent rendre compte chaque trimestre de leurs échecs. L’objectif est de se planter et de se planter vite car sans échec, pas d’innovation. C’est le fameux « Fail Fast ». Un exemple récent intéressant ! Google + qui a fermé et s’est avéré un gros échec, mais dont est née une technologie intégrée dans Google Photos, qui cartonne : tout est relatif !
Même pensée chez Ben&Jerry’s qui a même construit un cimetière qui rassemble tous les anciens parfums déchus et qu’il est même possible de visiter.

Enfin, Annabelle Roberts, autrice de La théorie de la veste, en a fait un objectif quotidien. Selon elle, il est important de se fixer un quota de vestes à prendre régulièrement afin d'apprendre à vivre avec cette peur d’échouer. En se confrontant à cette dernière, tu muscles ta résilience mais tu découvriras également que beaucoup de situations que tu anticipais comme des échecs se transformeront en opportunités inattendues (50% des vestes présumées selon l’autrice !).
Une méthodologie pratique pour apprendre de l’échec
J’espère t’avoir maintenant convaincu.e que la relation toxique que tu peux entretenir avec l’échec est purement psychologique. En intégrant que l’échec et la réussite sont intimement liés et que l’échec est une nécessité pour notre croissance, tu seras en mesure de mieux le vivre et d’en faire un atout.
Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut l’accepter tel quel et passer à autre chose. Comme le disait Einstein :
La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent.
En effet, de nombreuses études montrent que nous ignorons souvent les signes indiquant que nos relations ne vont pas bien ou que notre patron n'est pas satisfait de nos performances. Nous ne codifions pas les échecs et nous ne nous donnons pas la peine de tirer les leçons de nos succès. Cette aversion est qualifiée d'« effet d'autruche ».
Pour y remédier, voici une méthodologie complète pour gérer et apprendre de l'échec de manière constructive.
Reconnaître et accepter
Accepter l'échec comme une étape normale et inévitable du processus d’apprentissage est essentiel pour dépasser les sentiments négatifs qui l'accompagnent. Chaque échec n’est pas une fin en soi, mais un tremplin vers la réussite qui nous offre de précieuses leçons. Pour cela, une position proactive est nécessaire afin d’élaborer des stratégies pour éviter les mêmes erreurs à l'avenir.
Proposition d’exercice
Tenir un journal de tes échecs et succès
Écrire te permettra de clarifier tes pensées mais aussi d’identifier des motifs récurrents et de mettre en évidence les domaines où des changements sont nécessaires.
Demande toi par exemple : Qu'est-ce qui a mal tourné ? Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment ? Quelles leçons peuvent être tirées ?
En action avec Isabelle
Isabelle peut noter dans un journal ce qu’elle identifie comme échec et y détailler les différentes situations, le contexte, ses émotions, etc. Notamment, elle décrit en détail son dernier poste qu’elle a quitté avec une rupture conventionnelle en étant accompagnée vers la sortie.
Adopter une perspective à la troisième personne (auto-distanciation) & objective
Il est crucial de visualiser l'échec d’un point de vue extérieur. Cela permet de réduire l’impact émotionnel, d'éviter l'auto-flagellation, et de mettre en lumière des détails importants qui peuvent être obscurcis par des émotions négatives.
Proposition d’exercice
Écris une description objective d’un échec comme si quelqu’un d’autre que toi le racontait à une tierce personne.
Vérifie que tu n’inclus aucun jugement ni aucune émotion et concentre toi uniquement sur les faits.
Pour t’aider à voir où est ta part de responsabilité, trace un tableau à trois colonnes où chacune représente respectivement ta zone de contrôle, ta zone d’influence et ta zone de préoccupation.
Rappel fort utile
Dans notre environnement, on peut distinguer trois grandes dimensions :
- ce qui dépend directement de nous, notre cercle de contrôle où notre influence est totale (par ex : faire du sport; se lever à 8h, etc.)
- ce que nous pouvons influencer, notre cercle d’influence où notre influence est partielle et/ou indirecte (par ex : un entretien d’embauche, un examen)
- ce qui ne dépend pas de nous : notre cercle de préoccupation (par ex : le temps dehors, les décisions de l’Etat, le comportement des autres)
Note : les conséquences de nos erreurs font partie du cercle de préoccupations. Ni le regret, ni la justification des fautes servent, le temps avance et ne recule jamais.
La première dimension est ta zone de pouvoir car tu peux complètement l’influencer par tes actions. Par contre, la seconde est en dehors de ton contrôle.

Selon l’attention et l’attitude que tu adoptes, deux trajectoires très différentes se présenteront à toi :
- tu seras une personne réactive qui s’ajuste aux circonstances, au coup à coup. Ce sont ces dernières qui décideront à ta place.
- à l’inverse, tu seras une personne pro-active (active par anticipation) qui se concentre sur ce qui dépend d’elle.
En faisant, cet exercice, tu pourras identifier les domaines où tu as le pouvoir d’effectuer des changements et lâcher prise sur les éléments hors de ton contrôle.
Tu éviteras également de blâmer les autres ou les circonstances et tu pourras te concentrer sur les leçons à tirer et les actions correctives possibles.
En action avec Isabelle
Isabelle revient sur sa rupture conventionnelle.
Elle écrit sur sa situation comme si elle racontait l’histoire de quelqu’un d’autre : « Isabelle a accepté ce poste sans grand enthousiasme. Les attentes du poste se sont révélées très élevées, ce qui a augmenté la pression et a diminué son bien-être au travail. »
Elle dessine ensuite un tableau à trois colonnes représentant sa zone de contrôle, sa zone d’influence et sa zone de préoccupation.
- Zone de contrôle : ma motivation initiale, ma gestion de son temps.
- Zone d’influence : la communication avec mes supérieurs
- Zone de préoccupation : les retards de livraison des fournisseurs, l’inondation des locaux
Elle constate qu’elle pouvait agir sur sa motivation et sa gestion du temps à savoir ne pas accepter aussi rapidement un poste qui ne lui convenait pas totalement et avec des horaires et des contraintes géographiques qui ne correspondaient pas à ses impératifs (zone de contrôle).
Elle prend conscience qu’elle aurait pu tenter de mieux communiquer avec ses supérieurs concernant les attentes du poste (zone d’influence).
Par contre, elle ne pouvait pas être tenue responsable des conséquences de l’inondation des locaux.
Demander du feed-back constructif
La recherche de feedback constructif joue un rôle crucial dans le processus d'apprentissage et d'amélioration après un échec. Sollicite des retours honnêtes et constructifs de la part de personnes de confiance et d'expérience afin d’obtenir une perspective extérieure et objective qui viendra compléter et enrichir le travail d’auto-analyse que tu as fait précédemment.
Proposition d’exercice
Identifie les personnes susceptibles de te fournir des feedback constructifs et honnêtes.
Prépare des questions spécifiques pour aider ses interlocuteurs à structurer leurs retours.
Écris à ces personnes ou prends des rendez-vous individuels où tu expliqueras ta démarche et poseras tes questions.
En action avec Isabelle
Isabelle contacte un ancien superviseur. Elle lui pose des questions précises : Pouvez-vous me donner des exemples concrets où ma gestion du temps a posé problème? Quels sont les domaines où vous pensez que je devrais le plus m'améliorer ?
Après la rencontre, elle dispose de nouvelles clés pour compléter l’analyse précédente. Elle semble toujours extrêmement sûre d’elle et donne l’impression de tout maîtriser alors qu’au fond d’elle, elle attend de l’aide. Elle se rend compte qu’elle doit apprendre à demander.
Note : quand tu fais une demande de feed-back, penses toujours à remercier les personnes qui t’ont répondu pour le temps consacré et les conseils précieux donnés. Tiens les également informées de ton progrès et de tes futurs succès !
Chercher des pairs d’échec
Dans son livre Pouvoir illimité, Tony Robbins souligne l’importance de s’inspirer des personnes ayant déjà traversé des obstacles similaires et réussi à les surmonter. En modélisant leurs comportements, leurs attitudes et leurs stratégies, nous pouvons apprendre de leurs expériences et éviter certaines erreurs, gagnant ainsi un temps précieux et évitant des fausses routes. C’est ce qu'il appelle la « modélisation de l’excellence », une technique qu'il utilise pour aider les gens à atteindre rapidement leurs objectifs en copiant simplement ce que d'autres ont déjà prouvé être efficace.
L’histoire de Madam C.J. Walker, première femme millionnaire autodidacte aux États-Unis, incarne parfaitement cette idée de s'inspirer des pairs et de la modélisation de l'excellence.
Née Sarah Breedlove, et d’origine afro-américaine, elle est très tôt confrontée à la pauvreté, à l'adversité et aux problèmes personnels tels que la perte de ses cheveux.
Face à ces difficultés, elle ne se décourage pas et apprend des techniques de soins capillaires et des recettes de produits auprès d'Annie Malone, une entrepreneuse déjà établie dans le domaine.

Armée de ces nouvelles connaissances et compétences, Walker crée sa propre ligne de produits de soins capillaires. Elle développe également une stratégie de marketing innovante et forme des milliers de femmes pour devenir des "agents de beauté", leur offrant ainsi une source de revenus et une indépendance précieuses.
En tirant des leçons des succès et des échecs d'Annie Malone et en les appliquant à sa propre entreprise, Madam C.J. Walker a surmonté l'adversité pour bâtir un empire prospère, illustrant parfaitement la puissance de la modélisation de l'excellence et de l'apprentissage auprès des pairs. En apprenant des autres, elle a non seulement transformé sa propre vie, mais a également eu un impact positif sur la vie de milliers d'autres femmes, leur offrant des opportunités et une autonomie financière.
Élaborer une stratégie d'amélioration avec KPI et des objectifs SMART
Le développement d'une stratégie d'amélioration requiert la définition d'objectifs précis et mesurables pour guider et évaluer le progrès. Les objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, et Temporellement définis) et les KPI (indicateurs clés de performance) sont des outils essentiels pour ce processus.
Autrement dit, toute chose qui n’est pas mesurée ne peut pas être améliorée.
Si tu n’as pas de point de départ, difficile de comparer et savoir si tu as fait plus ou moins bien.
Pour choisir tes KPI, tu dois te demander quels sont les indicateurs les plus pertinents pour l’objectif visé. Par exemple, si l'objectif est d'améliorer la communication, un KPI pourrait être le nombre de présentations réalisées ou le feedback reçu après des réunions. Pour les objectifs SMART, il est important de les rendre aussi concrets et détaillés que possible, assurant ainsi une clarté et une orientation précise.
Prenons l'exemple de la société Toyota, célèbre pour son système de production, le Toyota Production System (TPS). Ce système a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale dans le but de rivaliser avec la production de masse des entreprises américaines, avec des ressources limitées.
Toyota s’est fixé des objectifs SMART clairs pour améliorer sa production:
- Spécifique : augmenter l'efficacité de la production tout en minimisant le gaspillage.
- Mesurable : réduire les délais de production de 50%.
- Atteignable : en implémentant de nouvelles méthodes de production et de gestion.
- Réaliste : avec la formation du personnel et l'optimisation des processus.
- Temporellement défini : atteindre cet objectif en cinq ans.
Les KPI utilisés par Toyota comprenaient des mesures telles que le temps de production, la quantité de matières premières utilisées, le nombre de défauts constatés, et le niveau de satisfaction des employés et des clients. Chaque KPI était régulièrement suivi et utilisé pour faire des ajustements continus dans leur processus de production, ce qui a finalement conduit à la réalisation de leurs objectifs.
L’approche de Toyota en matière d’objectifs SMART et de KPI a non seulement contribué à faire de l’entreprise un leader mondial de la fabrication automobile, mais elle a également révolutionné les pratiques de gestion et de production dans de nombreuses industries à travers le monde. La méthodologie Lean, largement adoptée aujourd'hui, est fortement inspirée du TPS.
Proposition d’exercice
Pour élaborer ta propre stratégie d'amélioration, commence par identifier clairement ce que tu dois changer et priorise le point sur lequel tu vas travailler. Tu le sais : on n’est pas efficace quand on court plusieurs lièvres à la fois.
Liste ensuite toutes les actions que tu dois/peux entreprendre pour atteindre cet objectif. Ensuite, divise-les en objectifs plus petits et plus gérables, en les formulant sous forme d'objectifs SMART.
Enfin, identifie également les KPI pertinents qui t’aideront à mesurer tes progrès vers ces objectifs.
En action avec Isabelle
Isabelle va certainement bien nous aider. Suite à son auto-anaylse et au retour de son superviseur, elle a décidé d’améliorer ses compétences en communication.
Elle liste toutes les idées qui lui viennent en tête.
Puis, elle fait le tri et définit des objectifs plus petits sous le chapeau de son grand objectif : assister à un atelier sur la communication, lire des livres sur le sujet et obtenir des retours de ses collègues sur ses compétences en communication.
Elle formule ses objectifs de manière SMART. Comme KPI, elle choisit le nombre d'ateliers suivis et les feedbacks reçus.
Évaluation et ajustement continu
La clé de la réussite à long terme réside dans l'évaluation et l'ajustement continu de la stratégie adoptée. Il est essentiel de mesurer régulièrement les progrès réalisés en fonction des objectifs fixés et d'ajuster la stratégie en conséquence pour maximiser les chances de succès futur. Cela implique une analyse régulière des résultats, une compréhension claire des succès et des échecs, et la capacité d'apporter des modifications proactives en fonction de ces informations.
Proposition d’exercice
1. Fixe-toi des points de contrôle réguliers : définis des moments précis (chaque semaine, mois, ou trimestre) pour évaluer tes progrès par rapport à tes objectifs fixés.
2. Analyse des données : examine les résultats obtenus à la lumière de tes KPI, identifie les zones de réussite et celles nécessitant une amélioration.
3. Ajuste la stratégie : en fonction des résultats, modifie tes objectifs, ton plan d'action ou tes méthodes si nécessaire en gardant bien en tête où se situent tes zones de contrôle et influence.
4. Demande des retours : n’attends pas d’être dans le mur pour demander des feedback à des personnes de confiance pour avoir une perspective externe sur tes progrès et ajustements.
Et quand l’échec se répète malgré tout ?

L'explication psychogénéalogique
L'échec répété sans raison apparente peut parfois être l'expression d’une loyauté familiale inconsciente, un concept issu de la psychogénéalogie, qui étudie les répercussions des événements et des traumatismes vécus par les générations précédentes sur les descendants.
Yann et la névrose de classe
Yann travaille dans une entreprise de logistique où il est directeur d’exploitation. Arrivé juste après ses études à un poste opérationnel, son travail a été récompensé par plusieurs promotions. Il est devenu cadre dirigeant. Tout semble lui sourire. Pourtant, depuis sa dernière promotion, il fait des erreurs, ses relations avec ses collègues s'enveniment et l’angoisse ne le quitte plus. Il souffre de migraines.
C’est en explorant ses racines que cet échec inexplicable s’explique : Yann est fils d'employés d'usine textile et petit-fils d'ouvriers. Il est issu d'un milieu humble. Sa famille n'a jamais connu le monde de l'éducation supérieure. Chaque échelon qu'il a gravi a creusé un fossé entre lui et ses racines.
Tiraillé entre deux mondes, ses conflits internes sont multiples :
- culpabilité d'avoir réussi là où ses parents n'ont pas pu, de ne pas avoir été loyal au destin familial ;
- honte de ses origines modestes ;
- honte d’avoir honte ;
- sentiment d'imposture et d'infériorité par rapport aux autres ayant les codes qu’il n’a pas.
C’est la névrose de classe à l'œuvre. Lorsque tu changes de milieu social, ton identité prend un coup. Ton identité héritée - le milieu d'où tu viens - entre en conflit avec ton identité acquise au fil de ton évolution. Cet écart progressif crée une tension qui génère de la souffrance.
Chez Yann, en plus de l’angoisse, il s’auto-sabote. Inconsciemment, en échouant, il réduit la tension entre ses deux identités.

Cet exemple très simplifié montre que l’ascension sociale nécessite un travail intérieur sur son identité.
Pour briser ces chaînes d’échecs répétés, la prise de conscience est la première étape cruciale. Comme le dit Carl Gustav Jung :
Jusqu’à ce que vous rendiez l’inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin.
Voici quelques clés :
- Prends conscience de l’influence de tes origines et de l’environnement dans lequel tu as grandi (par ex : réalise ton génosociogramme).
- Accepte et approprie-toi ton parcours afin de te libérer de la culpabilité et du sentiment d'imposture (l’approche narrative dont je te dis quelques mots dessous est un excellent outil).
- Travaille sur tes croyances afin de comprendre que ta valeur ne dépend pas de ta classe sociale, mais de tes compétences et de ton humanité.
Si la psychogénéalogie nous relie au passé et à l’inconscient, l’approche narrative du sentiment d’échec nous fournit des clés complémentaires. Parfois, l’échec peut être vu comme un acte de résistance.
Une manifestation du refus du pouvoir moderne: l’approche narrative de Michael White
Dans une société obsédée par le succès et le pouvoir, l'échec répété peut également être interprété comme un refus inconscient d'adhérer aux normes de succès modernes. L’approche narrative, développée par Michael White, offre une perspective unique sur ce phénomène. Selon White, les individus peuvent inconsciemment résister à la pression de conformité aux standards sociétaux, ce qui se manifeste sous forme d'échecs répétés.
Pour aborder ce type d’échec, l'élaboration d'une « carte narrative de l'échec » peut être utile. Il s'agit d’un exercice qui consiste à créer une histoire alternative, dans laquelle l'échec est vu non pas comme une défaite, mais comme une expression de valeurs personnelles profondes et de l'intégrité. Cette démarche aide à recontextualiser l'échec, à le dédramatiser, et à trouver de la valeur et du sens dans les expériences vécues, permettant ainsi de surmonter les sentiments d’inaptitude et la douleur associée à l'échec répété.
Exemple concret : Jean, un entrepreneur en échec
Prenons l'exemple de Jean, un entrepreneur qui a connu plusieurs échecs d'entreprise. Malgré son ingéniosité et son éthique de travail irréprochable, toutes ses entreprises n’ont pas survécu. Il se rend compte qu'inconsciemment, il a peur de la réussite car dans sa famille, la richesse est souvent associée à l’avarice et au manque d'éthique. Sans le savoir, Jean sabote ses propres efforts pour éviter d’être perçu comme quelqu’un de cupide.
La Carte Narrative (simplifiée)
La carte narrative est un outil puissant pour réécrire l’histoire de l’échec et le recontextualiser. Les étapes clés pour créer une carte narrative de l'échec incluent :
1. Identification de l’échec
Quel est l'échec que tu as vécu ? Comment cet échec est-il perçu par toi et par les autres ?
2. Exploration des valeurs sous-jacentes
Quelles sont les valeurs personnelles qui sont entrées en jeu dans cet échec ? Comment cet échec reflète-t-il tes convictions profondes ?
3. Reformulation de l’histoire de l’échec
Comment peux-tu réécrire l'histoire de cet échec pour refléter tes valeurs et convictions ? Quelle est la nouvelle histoire de ton échec ?
4. Recontextualisation
Comment cette nouvelle histoire change-t-elle ta perception de l'échec ? Quelle valeur et quel sens peux-tu trouver dans cette expérience révisée ?
Utilisation pratique avec Jean
Pour Jean, la première étape est de reconnaître et d’accepter son échec entrepreneurial. Il explore ensuite les valeurs sous-jacentes et les croyances qui ont pu contribuer à cet échec. En découvrant son aversion inconsciente pour la richesse, Jean peut commencer à reformuler l’histoire de ses échecs d'entreprise. Il peut maintenant voir que ses échecs ne sont pas le résultat d'un manque de compétence ou d'effort, mais plutôt une manifestation de sa loyauté envers des valeurs familiales profondément ancrées. En recontextualisant ses échecs de cette manière, Jean est en mesure de trouver du sens et de la valeur dans ses expériences, et peut travailler pour surmonter les obstacles internes qui l'ont retenu.
En conclusion

Pour conclure brièvement, l'échec n'est pas fatal, mais l'échec à changer pourrait l'être. Tout dépend de la façon dont tu le prends. Tu peux l'utiliser comme une marche vers le haut ou comme un marteau pour te frapper toi-même. Utilisez-le comme une marche vers le haut. L'échec ne veut pas dire que tu es un échec... cela signifie seulement que tu n’as pas encore réussi.
Fail early, fail often, but always fail forward.
Échouez tôt, échouez souvent, mais échouez toujours en avançant.
— John C. Maxwell
Si cette exploration t’a touché.e ou interpellé.e, n'hésite pas à me partager tes découvertes et tes réflexions en répondant simplement à cette newsletter. Sinon, dis moi simplement merci en appuyant sur le coeur ❤️ en bas de cette newsletter. Pour moi, cela veut dire beaucoup !
Je te souhaite une excellente semaine & me réjouis de te lire !
Hélène