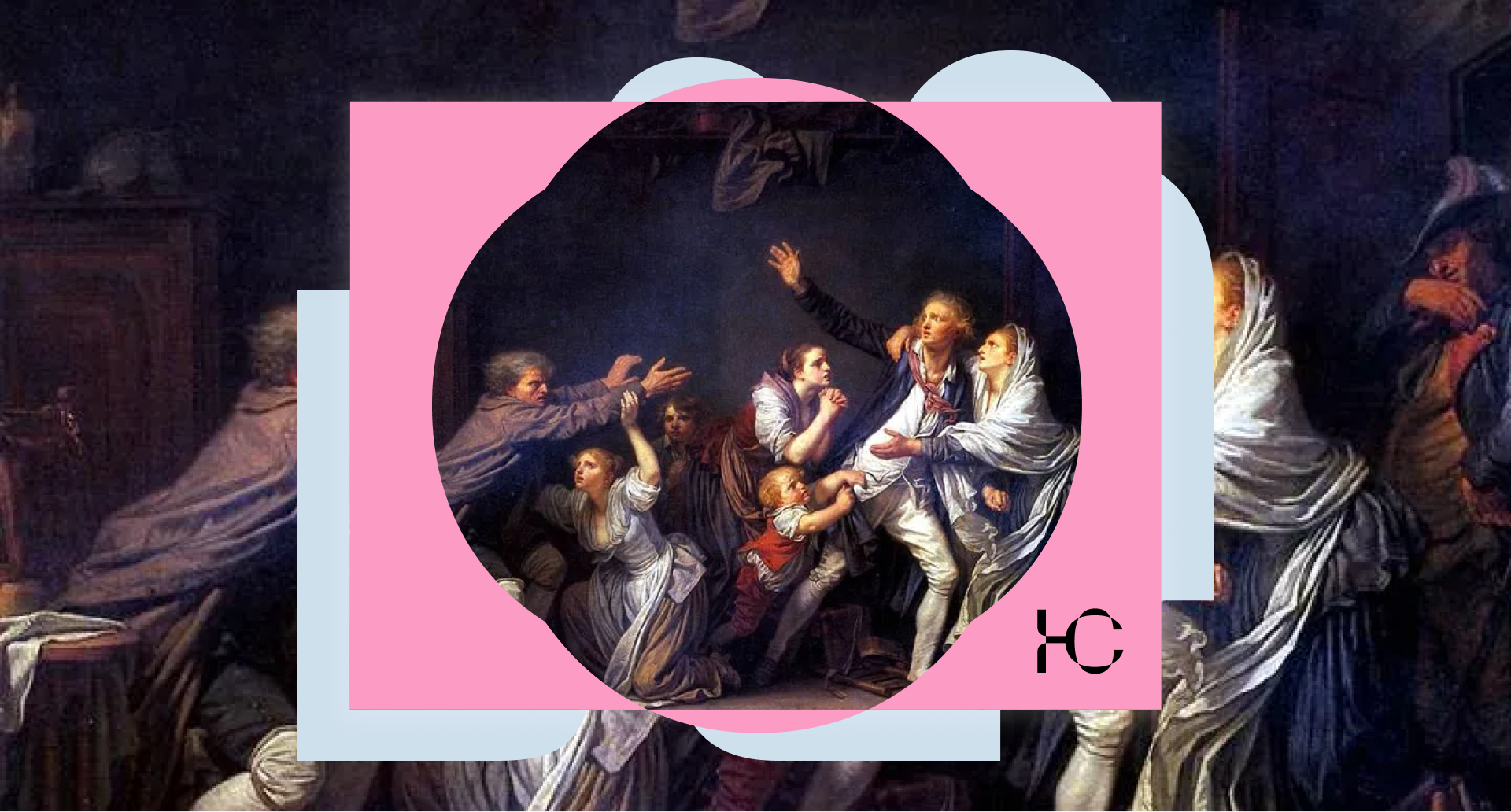Cher toi,
Encore une fois, tu auras pu constater que je me suis octroyée une pause. Elle était nécessaire pour trouver - enfin - un rythme plus écologique.
Comme quoi, j’ai beau adorer le sujet de l’organisation et avoir testé plein de systèmes, c’est un ajustement perpétuel - tout comme l’est l’équilibre de nos vies. Nous restons des funambules au quotidien.

Parfois, il faut accepter que quand cela ne rentre pas, rien ne sert de s’acharner à vouloir gonfler la grenouille pour qu’elle devienne un boeuf. Il vaut mieux reconnaître la chimère et prendre le temps de prendre le temps de s'arrêter pour revoir notre approche et repartir d’un meilleur pied.
Pour rebondir et faire le lien avec le sujet de la dette et du don, au cœur de notre nouvelle mini-série, il faut savoir prendre pour pouvoir (re)donner et cela s'applique également à notre gestion du temps.
Pourtant, dans notre société, il est tabou de penser - et encore plus de dire à haute voix - qu’on tient des comptes quand on parle de nos relations et de nos actions.
Le don gratuit est sacralisé et la dette diabolisée.
On préfère se déclarer âme charitable et purement désintéressée, alors que si on prend - ne serait-ce qu’un peu le temps - d’observer la course de nos pensées, nous ne pouvons que constater que notre calculette interne est toujours activée.

Besoin d’être convaincu.e ? Réponds aux deux questions suivantes.
- Connais-tu à l’euro prêt l’état de ton compte ?
- Par contre, si je te demande qui a reçu le plus d’attention dans ta famille, si ton collègue t’a salué vendredi matin, la dernière fois que ton chef t’a félicité ou bien qui la personne à qui tu as rendu un service sans être remercié, je suis sûre que toutes les réponses te viendront bien plus aisément.
Tu l’auras certainement constaté : on tient compte de beaucoup de choses. Et on compte encore plus lorsqu’il s’agit de mesurer ce que font ou ne font pas les gens qui comptent pour nous.
Alors, quand nous parlons de la beauté et de la possibilité du don gratuit, ne serions-nous pas en train de nous conter (vs compter) de belles histoires pour justifier nos préjugés moraux ?
Oui, il n’est pas facile d’admettre que l’on compte. Mais, contrairement à ce que pense le commun des mortels et pour te montrer que tu n’es pas une âme cruelle, sache que les bons comptes ne font pas uniquement les bons amis.
Ils sont à la source de notre cohésion sociale, de notre sentiment d’appartenance, des notions phares de justice et équité & tout simplement de notre survie.
Tu le verras - à l’aide de nombreux exemples - les bons sentiments sont parfois toxiques, voire destructeurs.
Ce que tu vas écouter sera peut-être parfois dérangeant, mais je t’assure qu’on a tout à gagner en élargissant notre champ de vision et en variant les perspectives !
Bonne écoute.
Notes : je me suis enflammée dans ce deuxième épisode. J’avais tellement de choses à te raconter que j’ai enregistré pratiquement 1h30 de contenu.
Toutes les parties forment un tout mais pour éviter de t’effrayer et pour faire durer le plaisir, j’ai décidé de découper les trois parties en différents sous-épisodes.
La première partie est disponible dès aujourd’hui, la seconde sortira mercredi et la troisième dimanche prochain avec les notes de la partie 2 et 3.
Le potlatch et le cycle du don
Dans la première partie de ce second épisode de notre mini-série consacrée à la dette, nous explorons :
1️⃣ ce qu'est le potlatch ;
2️⃣ le rapport entre le don social et le don personnel ;
3️⃣ le cycle du don et les conséquences quand il est interrompu.
I. Le potlatch
Toutes les recherches en sociologie et en psychologie le montrent : il ne peut exister de don sans retour et cela même si les deux parties - donataire et bénéficiaire - le souhaitent de tout cœur car, dans ce cas, la dette sera tout de même payée mais par un comportement inconscient et toxique.
C’est Marcel Mauss avec son ouvrage de référence “Essai sur le don” qui a mis en lumière la relation fondamentale entre le cadeau - le don - et la dette, ainsi que l’obligation de rendre.
1. Quelques mots sur la coutume primitive
Avant d’arriver à un constat universel, il a observé, en premier lieu, la coutume du potlatch (donner en Chinook) chez des tribus amérindienne.
Il s’agit d’un événement hautement ritualisé où les membres d'une communauté se réunissent pour célébrer des occasions importantes telles que les mariages, les funérailles, les naissances ou les changements de statut social.

L'aspect central du potlatch est l'échange de cadeaux, de nourriture et de biens matériels entre les hôtes et les invités.
Ces échanges ne sont pas seulement des actes de générosité, mais ils servent également à démontrer le statut social et la richesse de l'hôte.
C’est un échange compétitif, une lutte de rivalité, qui se sert des cadeaux comme armes.
Les règles sont les suivantes :
- En donnant de l’avoir, on acquiert de l’être.
- Celui qui donne est supérieur à celui qui reçoit.
- Plus on donne de richesse, plus on acquiert de prestige.
- En donnant, on prend l’ascendant sur celui qui reçoit.
2. Le cycle du don
Dans ces cérémonies, Marcel Mauss distingue trois obligations indissociables : donner, recevoir, et rendre.
1. Dans un premier temps, il faut donner pour montrer sa supériorité sinon cela montre une incapacité à diriger le groupe ou tout simplement son infériorité.
2. Dans un second temps, celui qui reçoit est obligé moralement d’accepter ce don sinon il reconnaît son infériorité.
3. Dans une troisième temps, celui qui a reçu ce don se doit de faire un contre-don. Il est obligé de répondre au défi lancé.

Le potlatch est basé sur la réciprocité différée et le principe est de toujours surpasser son rival en générosité.
Le processus s'arrête lorsque la réciprocité ne peut plus être soutenue, conférant pouvoir et prestige au dernier donateur capable de surpasser son adversaire.
Les dons et contre-dons ne sont donc pas destinés à l’enrichissement, mais ils permettent de renforcer les liens communautaires tout en démontrant la capacité du chef à soutenir sa communauté. Ainsi, ce dernier solidifie son statut social et son influence.
II. Un phénomène universel
Tu te demandes peut-être à ce stade quel est le rapport avec le fonctionnement de notre société et ton fonctionnement à toi.
Ces traditions, au début associées uniquement aux tribus primitives, ont finalement pu être observées partout dans le monde.
L’obligation de remboursement n’est pas folklorique mais au contraire universelle. Elle trouve sa racine commune dans le désir de cohésion sociale.
1. Le don et la dette dans notre société moderne
Dans notre société moderne, l'obligation de rendre un équivalent pour tout présent fait partie du tissu social, mais elle est souvent dissimulée.
Des exemples comme les cadeaux de Noël, les invitations ou les échanges de politesse illustrent cette dynamique. L'expression allemande "sich revanchieren" révèle la nature de réciprocité qui sous-tend ces échanges.
2. Parallèles entre les traditions du potlatch et les pratiques contemporaines
Des parallèles évidents existent entre les pratiques du potlatch et les coutumes contemporaines, notamment avec des symboles comme la bague de fiançailles en diamants.
La campagne de marketing de De Beers et l'idée du "Diamond is Forever" sont un bon exemple d‘instrumentalisation de cette dynamique.
Comment ne peut voir la similitude entre l'achat de bijoux coûteux et socialement valorisés et les dons ostentatoires du potlatch ?

3. Les mécanismes sociaux du don et de la dette
Les mécanismes sociaux du don et de la dette servent à affirmer le statut social et à maintenir l'équilibre des relations. Des exemples historiques montrent comment les dons étaient faits en échange de faveurs ou de protection. Refuser de reconnaître cette dynamique peut conduire à une culpabilisation injustifiée et à une incompréhension des mécanismes sous-jacents du don et de la dette.
Alors, pourquoi continuons-nous de penser que le don se doit d’être gratuit ? Pour des histoires de morale mal placée. Pourtant, nous allons le voir : celui qui refuse à l’autre le plaisir de s’acquitter de sa dette ne fait rien d’autre que l'inférioriser et le maîtriser.
Notes : le don privé, entre personnes, ne se fait pas (que) par des échanges de biens matériels et la dette qu’il implique peut être comblée par de la reconnaissance, de la tendresse. Celle-ci ne doit pas forcément être quantifiée et équivalente.
III. Du don social au don psychique
1. Les caractéristiques du don social
- Le don social implique une obligation de réciprocité et est généralement ritualisé.
- Il crée une dette sociale qui doit être apurée par un contre-don d'une valeur équivalente.
- Le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences sociales sévères, comme l'exclusion de la société.
2. Le don psychique et ses implications
- Le don psychique crée une relation similaire au don social, mais sur un plan plus personnel et psychologique.
- Il ne peut être refusé sans risquer de conflit, et la dette psychique résultante est souvent d'ordre émotionnel ou symbolique.
Le non-remboursement de cette dette peut entraîner un sentiment d'infériorité chez le bénéficiaire et des troubles psychologiques.

IV. Les dettes inconscientes
1. Différences entre le don social et le don personnel
Le don social est public et ritualisé, tandis que le don personnel est privé et non ritualisé. Il n’est souvent connu que du couple donataire / bénéficiaire et seuls eux peuvent en évaluer la valeur. L’évaluation de cette valeur - souvent non signifiée - peut varier entre ces deux personnes.
C’est donc en quelque sorte ce manque de clarté et de transparence qui rendent son évaluation beaucoup plus difficile et est à l’origine des conséquences néfastes que peuvent avoir un mauvais calcul.
En effet, le souvenir du don personnel pourra être sous-estimé, voir refoulé et nié ou à l’inverse grandement surestimé, entraînant des remboursements inadaptés et des troubles psychologiques.

2. Typologie des dettes toxiques
J’ai isolé cinq types de dettes toxiques :
- La dette refoulée : le souvenir du don est oublié, nié et refoulé dans l'inconscient.
- La dette minimisée : le bénéficiaire minimise la valeur du don reçu et donc de la dette associée.
- La dette surévaluée : le bénéficiaire surestime la valeur du don et par conséquence de sa dette.
- La dette auto-infligée : le bénéficiaire donne de manière compulsive mais ne veut rien recevoir en retour, tout en se sentant tout même lésé.
- Les dettes négatives : ce sont les dettes qui résultent de comportements prédateurs ou de manipulation, un don de malheur ou de violence par exemple.
🚨 Pour en savoir plus, tu retrouveras le détail de chacune de ces dettes avec des exemples précis dans la seconde partie de cet épisode qui paraîtra mercredi 8 mai.
Le défi de la semaine
Laisse infuser ce premier épisode !
Si tu as envie de réfléchir à une question en particulier, je te propose de t‘interroger sur un cadeau, un don d’importance que tu as reçu d’un parent ou d’un ami et de te demander comment il s’est inscrit dans le cycle Donner - Recevoir - Rendre.
👉🏻 Dans quelle partie de la boucle te situes-tu ?
👉🏻 Quel est ton sentiment à l’égard de ce don et pourquoi ?
Partage moi tes questions et tes investigations en répondant à ce mail ou en me laissant un vocal ici. Je te répondrai en personne et j’ajouterai nos réflexions au prochain épisode.
Excellent dimanche et à la semaine prochaine,
Hélène
PS 1 : la meilleure manière de me dire merci est d’écrire un commentaire sur ton appli de podcast (tu auras ma plus grande reconnaissance !).
PS2 : si ce n’est pas déjà fait, tu peux aussi :
- me suivre sur Linkedin et Instagram.
- booker un call découverte de 30 mn (offert).
- lire toutes les éditions précédentes.